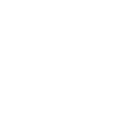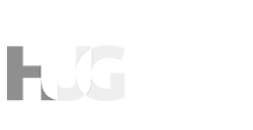_
_
INFOS
DÉTAILLÉES
OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Objectif 1 :
décrire le vécu lié aux soins oncologiques des patient·e·s diagnostiqué·e·s avec les six cancers les
plus fréquents en Suisse (sein, prostate, poumon, colorectal, peau et sang) et traité·e·s dans
quatre hôpitaux de quatre cantons romands
Objectif 2 :
examiner la variation du vécu en soins oncologiques selon le
type de cancer et le type d'hôpital
Objectif 3 :
déterminer les caractéristiques liées au patient
(caractéristiques sociodémographiques, psychosociales et cliniques) et associées au vécu
Objectif 4 :
poursuivre les analyses psychométriques de la version
française (pour la Suisse) du questionnaire de l'enquête sur le vécu en soins oncologiques des
patient·e·s atteint·e·s du cancer (par exemple identifier les dimensions sous-jacentes).
PATIENT·E·S CIBLÉ·E·S PAR L’ÉTUDE
Patient·e adulte (≥18 ans)
Diagnostic confirmé de cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du poumon, cancer colorectal,
mélanome, ou cancer hématologique (leucémie, lymphome, myélome)
Admis·e ou vu·e dans un des hôpitaux participants en ambulatoire ou en stationnaire
Pour un traitement, soin, ou suivi lié au cancer
Entre les dates du 1er janvier et du 30 juin 2018.
COMMENT PARTICIPER ?
Les patient·e·s éligibles à participer à l’étude ont reçu à la maison une enveloppe avec la lettre d’invitation, la feuille d’information, le questionnaire papier et une enveloppe retour déjà affranchie. Il est possible de répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le nom de l’hôpital qui a envoyé la lettre d’invitation, ci-dessous. Le numéro d’identifiant et le code nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne se trouvent dans la lettre d’invitation.
DATES CLÉS
| Fin octobre 2018: | Envoi du questionnaire au domicile des patient·e·s |
| Fin novembre 2019: | Envoi du rappel aux patient·e·s qui n’ont pas encore renvoyé le questionnaire |
| Janvier – Août 2019: | Analyses et rédaction des rapports |
| Septembre 2019: | Publication des résultats publics sur le site internet Envoi des résultats aux participant·e·s |
| Octobre 2019: | Présentation des résultats aux hôpitaux |
FINANCEUR
L’étude est financée par la Recherche suisse contre le cancer.
QUESTIONNAIRE
L’étude SCAPE utilise la traduction française et adaptée au contexte suisse du questionnaire anglais « NHS Cancer Patient Experience Survey ». Le questionnaire inclut des questions sur les expériences de soins avant d'aller à l'hôpital pour un traitement du cancer, les tests diagnostiques, l’annonce du diagnostic, les décisions concernant le traitement, les expériences de soins reçus à l’hôpital en ambulatoire et durant l'hospitalisation (y compris opérations sur le cancer, radiothérapie et chimiothérapie), et les expériences de soins et soutien à domicile. Il comporte également une question sur la satisfaction générale et un espace pour les commentaires libres. Le questionnaire comprend des questions sur l’état de santé et sur des informations personnelles comme le sexe et l’âge.
CONFIDENTIALITÉ
Pour garantir l’anonymat et la confidentialité des données, une procédure de codage a été mise en
place. Le codage signifie que les informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro
de patient) ont été remplacées par un « code » à 4 chiffres. Les données recueillies avec le
questionnaire contiennent ce code ; elles ne contiennent pas de nom ou d’adresse. La clé du code (le
lien entre les données personnelles et le code) se trouve dans un document protégé par un mot de
passe, uniquement accessible au coordinateur local de l’hôpital participant. Les données du
questionnaire seront ensuite anonymisées (le document avec la clé du code sera détruit) après la
phase de collecte des données. Il sera alors impossible de lier les réponses à un nom.
Toutes les directives relatives à la protection des données sont respectées. Cette étude est
effectuée dans le respect des prescriptions de la législation suisse. La commission cantonale
d’éthique compétente a contrôlé et autorisé l’étude.
RÉSULTATS
Sur les 7'145 patient·e·s invité·e·s à participer à l’étude, 3'121 ont rempli et renvoyé le questionnaire, soit un taux de participation de 44%.
Premiers résultats : dans l'ensemble, l’expérience des patient·e·s est positive en ce qui concerne les tests de diagnostic, les contacts avec l'infirmier·ère clinicien·ne spécialisé·e, les opérations, ainsi que les soins reçus lors des hospitalisations ou traitements ambulatoires. L’expérience est moins positive en ce qui concerne les informations reçues au moment du diagnostic, les indications sur les effets secondaires du traitement, les aspects psychosociaux et financiers liés à la maladie, le soutien après le traitement et l’implication de la famille.